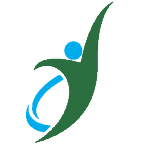Symposiums acceptés
La technologie pourrait-elle révolutionner les lignes directrices et les interventions en matière d'activité physique ?
Auteur de la soumission
Groupe de population
Type d'étude
Paramètres
Activité physique pour les personnes âgées et les personnes handicapées : preuves et exemples de programmes évolutifs
Auteur de la soumission
Groupe de population
Type d'étude
Paramètres
Comportement et promotion de l'activité physique dans une perspective systémique
Auteur de la soumission
Groupe de population
Type d'étude
Paramètres
Impact de la série The Lancet Physical Activity et avenir de la recherche sur l'activité physique
Objectif : étudier l'impact des séries 2012, 2016 et 2021 de The Lancet Physical Activity et donner un aperçu des principaux résultats d'une série à venir.
Description : Publier dans la revue The Lancet est particulièrement important en raison de sa visibilité, de sa portée étendue et de son influence considérable sur la santé publique et la pratique médicale dans le monde entier. Ainsi, les séries The Lancet Physical Activity de 2012, 2016 et 2021 ont fourni une plateforme pour une large diffusion des résultats de la recherche sur des sujets hautement prioritaires dans le domaine de l'activité physique. L'objectif principal de la série était de faire progresser la compréhension et la promotion de l'activité physique dans le monde entier. Ce symposium comprendra quatre présentations, à commencer par une perspective historique et l'impact de la série The Lancet Physical Activity, ainsi qu'une vue d'ensemble des trois séries précédentes. Les présentations 2 à 4 seront suivies d'une vue d'ensemble des nouveaux articles à paraître qui seront inclus dans la quatrième série de The Lancet Physical Activity. Ces présentations aborderont de nouveaux sujets cruciaux, notamment (a) l'équité en matière de santé et un changement de paradigme selon lequel l'activité physique n'est pas uniquement liée aux maladies non transmissibles (MNT), mais adopte une approche synergique, (b) l'examen du lien entre l'activité physique et le changement climatique/la durabilité environnementale, et (c) l'importance de développer des politiques efficaces en matière d'activité physique à l'échelle mondiale. La première présentation (Professeur Pedro Hallal) résumera les principales conclusions et contributions des trois séries au cours de la dernière décennie et expliquera comment les séries passées sont considérées comme un effort significatif pour faire progresser la science de l'activité physique et les domaines connexes. Le deuxième exposé (professeur associé Deborah Salvo) présentera le premier article de la quatrième série, qui explore la manière dont l'ère actuelle des syndromes présente des crises mondiales interdépendantes de maladies infectieuses, de maladies non transmissibles, de problèmes de santé mentale, d'inégalités persistantes en matière de santé et de changement climatique, qui peuvent toutes bénéficier de l'activité physique. La troisième présentation (Professeur Erica Hinckson) renforcera le double objectif de réunir les agendas de l'activité physique et du climat pour traiter la santé humaine et planétaire en adoptant d'urgence une approche collaborative multisectorielle qui se concentrera sur des actions globales et holistiques par le biais d'un changement de politique. Enfin, la quatrième présentation (professeur assistant Andrea Ramirez Varela) proposera une réflexion critique sur le suivi des politiques mondiales en matière d'activité physique afin d'évaluer les progrès accomplis dans les politiques nationales et mondiales de prévention de l'activité physique et des maladies non transmissibles pour guider les efforts, éclairer la prise de décision et conduire des actions visant à favoriser des populations en meilleure santé et à atténuer la prévalence de l'inactivité physique à l'avenir.
Ce symposium permettra de partager les enseignements des équipes de recherche de six régions du monde, en mettant l'accent sur la discussion, la réflexion et la vision pour guider l'avenir de l'activité physique dans les décennies à venir.
Président : Professeur Pedro Hallal, Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, USA
Présentateur 1 : Professeur Pedro Hallal. Département de kinésiologie et de santé communautaire, Université de l'Illinois Urbana-Champaign, Champaign, Illinois, États-Unis.
Présentateur 2 : Professeur associé Deborah Salvo. Département de kinésiologie et d'éducation à la santé, Université du Texas à Austin, Austin, États-Unis.
Présentateur 3 : Professeur Erica Hinckson, Département de l'activité physique et de la nutrition, École des sports et des loisirs, Faculté des sciences de la santé et de l'environnement, Université de technologie d'Auckland, Nouvelle-Zélande
Présentateur 4 : Andrea Ramirez Varela, professeur adjoint. Département d'épidémiologie, de génétique humaine et de sciences de l'environnement, Centre des sciences de la santé de l'Université du Texas à Houston (UTHealth), États-Unis.
Discutants/modérateurs (panel) : ordre alphabétique
-Professeur Adrian Bauman, Centre Charles Perkins, École de santé publique de Sydney, Université de Sydney, Sydney.
-Professeur Harold Kohl III, Département de kinésiologie et d'éducation à la santé, Université du Texas à Austin. Austin, États-Unis.
Professeur Jim Sallis, École de santé publique Herbert Wertheim, Université de Californie à San Diego, La Jolla, Californie, États-Unis.
-Professeur associé Melody Ding. Centre Charles Perkins, École de santé publique de Sydney, Université de Sydney. Sydney, Australie.
-Professeur Michael Pratt. École Herbert Wertheim de santé publique et de sciences de la longévité humaine, Université de Californie à San Diego. San Diego, États-Unis ; Institut de santé publique, Université de Californie à San Diego. San Diego, États-Unis.
-Professeur Rodrigo Reis, Brown School, Université de Washington à St. Louis, États-Unis.
-Professeur Ulf Ekelund, Département de médecine du sport, École norvégienne des sciences du sport. Oslo, Norvège.
Résumé 1 : Historique et impact de la série sur l'activité physique de The Lancet (2012, 2016, 2021)
Contexte : En 2012, The Lancet a présenté sa série inaugurale sur l'activité physique (AP) pendant les Jeux olympiques d'été de 2012, mettant en lumière la statistique alarmante selon laquelle l'inactivité physique contribue à plus de 5 millions de décès dans le monde chaque année, un chiffre équivalent à celui des décès liés au tabagisme. Les séries suivantes, en 2016 et 2021, ont mis l'accent sur la nécessité urgente de s'attaquer à l'importante charge de morbidité associée à l'inactivité physique, en se concentrant sur les comportements sédentaires, l'invalidité et les populations à risque.
Objectif : Nous explorons l'héritage de dix ans de la série The Lancet PA et mettons à profit les connaissances acquises pour explorer une nouvelle série.
Méthodes : En utilisant l'évaluation bibliométrique et d'autres méthodes, nous avons synthétisé les connaissances et l'expérience accumulées au cours de la dernière décennie et l'impact de la série sur les domaines de l'activité physique et de la santé publique. En particulier, nous avons étudié les citations, les mentions, les comparaisons avec d'autres séries du Lancet, les utilisateurs par pays et par profession, et l'utilisation des politiques.
Résultats : La série The Lancet a eu un impact profond sur les domaines de l'activité physique et de la santé publique. Dans cette présentation, nous développerons la nature de l'impact sur la recherche, l'enseignement et la politique.
Conclusions : L'héritage laissé par la série The Lancet PA servira de base à une nouvelle orientation de la recherche sur l'activité physique, qui permettra de mieux informer les politiques et les pratiques.
Implications pratiques : Les enseignements tirés devraient avoir des implications pratiques pour la santé publique, l'élaboration des politiques et la collaboration internationale. Les connaissances acquises sont bien placées pour éclairer les stratégies fondées sur des données probantes en vue de relever les défis mondiaux par des interventions ciblées liées à l'activité physique, et donc de contribuer à l'avancement des programmes de santé publique dans le monde entier.
Résumé 2 : Reconceptualisation de l'activité physique à l'ère des syndromes à l'aide d'une lentille d'équité globale.
Contexte : Les communautés médicales et de santé publique reconnaissent généralement l'importance de l'activité physique pour la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles (MNT). Toutefois, l'importance de l'activité physique dans la résolution d'autres problèmes mondiaux majeurs est moins bien reconnue.
Objectif : Ce document utilise une optique d'équité mondiale pour mettre en lumière les avantages de l'activité physique, au-delà de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles, pour l'âge des syndémies (pandémies cooccurrentes et défis mondiaux majeurs).
Méthodes : À l'aide de données de l'OMS représentatives au niveau national et provenant de 68 pays, nous avons effectué une analyse harmonisée de l'activité physique spécifique aux domaines des loisirs, du transport et du travail, en utilisant des diagrammes d'équité et des indices de pente pour quantifier les inégalités socio-économiques et fondées sur le sexe. Ensuite, nous avons procédé à une analyse systématique des études sur l'activité physique pendant la pandémie de COVID-19, car cette crise mondiale récente a mis en évidence l'importance de l'activité physique pour la santé publique à l'ère des syndromes.
Résultats : Les données prépandémiques ont révélé des inégalités socio-économiques à l'intérieur des pays et entre les pays, avec une prévalence plus élevée de l'activité physique de loisir dans les pays et les groupes à revenu élevé et une prévalence plus élevée de l'activité physique utilitaire dans les pays et les groupes à faible revenu. L'analyse des données sur les inégalités fondées sur le sexe est en cours. L'analyse des études sur COVID-19 et sur l'activité physique a montré que (a) les inégalités en matière d'activité physique ont pu se creuser à cause de COVID-19 ; (b) l'activité physique a été inversement associée aux résultats négatifs liés à COVID-19, soulignant l'importance souvent méconnue de l'activité physique pour les maladies infectieuses et l'immunité ; et (c) l'activité physique a pu atténuer certaines des conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale, soulignant ses bienfaits pour la santé mentale.
Conclusions : L'ère actuelle de la syndémie est confrontée aux crises mondiales des maladies infectieuses et des maladies non transmissibles, aux problèmes de santé mentale, aux inégalités persistantes en matière de santé et au changement climatique, autant de problèmes qui peuvent bénéficier de l'activité physique.
Implications pratiques : Il est essentiel de reconceptualiser l'activité physique comme un facteur très pertinent pour de multiples éléments des syndromes modernes.
Résumé 3 : Vivre, bouger et jouer sur une planète durable et saine : l'urgence de combiner les agendas de l'activité physique et du changement climatique
Contexte : Le changement climatique est la catastrophe auto-infligée la plus dangereuse que l'humanité ait jamais connue, et l'inactivité physique est responsable de plus de 5 millions de décès par an dans le monde.
Objectif : Nous avons la possibilité d'aligner et de mobiliser les politiques, la recherche et l'action en vue d'atteindre le double objectif d'atténuer les risques liés au changement climatique et de promouvoir la santé humaine grâce à l'activité physique.
Méthodes : Nous conceptualisons l'interconnexion entre les cadres sur l'activité physique et le changement climatique à travers les Stratégies qui marchent pour l'activité physique de l'ISPAH en utilisant des outils de pensée systémique appliquée. Nous abordons également les conséquences involontaires, considérons les inégalités et proposons des cadres analytiques pour des recherches ultérieures. L'activité physique est à bien des égards liée au changement climatique.
Résultats : Les solutions en matière d'activité physique peuvent compléter la réponse au changement climatique. Nous proposons un cadre d'action dans lequel la promotion de l'activité physique peut simultanément réduire les inégalités en matière de santé et d'environnement, atténuer le changement climatique et adapter à long terme l'environnement et les comportements à un climat changeant.
Conclusions : Pour faire progresser équitablement les programmes relatifs à l'activité physique et au changement climatique, il faut tenir compte du contexte et des contributions des populations vulnérables, notamment des habitants des pays à faibles revenus et des connaissances ancestrales des peuples indigènes.
Implications pratiques : Il est urgent d'accorder la priorité au double objectif consistant à réunir l'activité physique et les programmes climatiques pour traiter la santé humaine et planétaire, en adoptant une approche collaborative multisectorielle axée sur des actions globales et holistiques par le biais d'un changement de politique et de réformes budgétaires. Ces changements nécessiteront l'élaboration de cadres politiques, la mise en place d'incitations financières, l'imposition de pratiques durables et le lancement de campagnes d'éducation et de sensibilisation donnant la priorité à l'activité physique dans le double but de protéger l'environnement et la santé des individus.
Résumé 4 : Deux décennies de progrès dans les politiques nationales et mondiales en matière d'activité physique
Contexte : La politique en matière d'activité physique peut jouer un rôle important en associant plusieurs secteurs de la société pour créer des environnements favorables à l'augmentation de l'activité physique de la population.
Objectif : Ce projet avait pour but de documenter les tendances en matière de politique d'activité physique au niveau mondial.
Méthodes : Nous avons évalué l'évolution des politiques mondiales en matière d'activité physique entre 2004 et 2023 en nous basant sur le suivi des politiques de l'Observatoire mondial de l'activité physique (GoPA !) dans 217 pays.
Résultats : Les données classées par GoPA ! mettent en évidence une augmentation notable à partir de 2012 (année de la première série The Lancet Physical Activity) de la prévalence des politiques nationales en matière d'activité physique au cours des deux dernières décennies. Environ neuf pays sur dix (89,4%) disposent désormais de politiques officielles écrites, qu'il s'agisse d'une politique nationale sur les maladies non transmissibles incluant l'activité physique ou d'une politique autonome sur l'activité physique. Le nombre de politiques autonomes est plus élevé dans la région européenne que dans les autres régions de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'Afrique, l'Asie du Sud-Est et les pays à faible revenu présentent des lacunes persistantes en ce qui concerne la disponibilité des politiques et des lignes directrices. Dans pratiquement tous les pays, l'évaluation de la mise en œuvre des politiques a été médiocre. La majorité des politiques mises en œuvre dans le monde étaient limitées dans le temps et, si aucune mesure n'est prise, elles prendront fin avant ou en 2030, année à laquelle l'OMS cherche à réduire les facteurs de risque au niveau mondial et souhaite parvenir à une réduction relative de 15% de l'inactivité physique.
Conclusions : De nombreux progrès ont été réalisés depuis 2012 en matière de systèmes et d'outils de suivi des politiques, mais le suivi systématique des politiques d'activité physique à l'échelle mondiale, y compris la mise en œuvre et l'évaluation, n'a pas encore été réalisé.
Implications pratiques : Le suivi des politiques mondiales en matière d'activité physique afin d'évaluer les progrès accomplis dans les politiques nationales et mondiales de prévention de l'activité physique et des maladies non transmissibles permet d'orienter les efforts, d'éclairer la prise de décision et de mener des actions visant à favoriser des populations en meilleure santé et à réduire la prévalence de l'inactivité physique.
Financement : Observatoire mondial de l'activité physique (GoPA !)
Auteur de la soumission
Groupe de population
Type d'étude
Paramètres
Quand la politique est nécessaire mais insuffisante pour lutter contre l'inactivité : Sommes-nous à la hauteur du défi ?
Auteur de la soumission
Groupe de population
Type d'étude
Paramètres
Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Discussion sur les moyens de créer avec les jeunes des quartiers propices à l'activité.
Auteur de la soumission
Groupe de population
Type d'étude
Paramètres
Développer et pérenniser les interventions en matière d'activité physique : Une montagne trop haute ?
Auteur de la soumission
Groupe de population
Type d'étude
Paramètres
Inégalités en matière d'activité physique chez les enfants des pays à revenu faible et intermédiaire : l'étude internationale SUNRISE
Auteur de la soumission
Groupe de population
Type d'étude
Paramètres
Activité physique : plus il y en a, mieux c'est, ou le contexte et l'équilibre comptent-ils ?
Auteur de la soumission
Groupe de population
Type d'étude
Paramètres
Promouvoir l'activité physique dans les systèmes de santé au niveau mondial
Auteur de la soumission
Groupe de population
Type d'étude
Paramètres
Développement de la promotion de la santé dans les clubs sportifs : interventions, compétences clés, succès et défis
Auteur de la soumission
Groupe de population
Type d'étude
Paramètres
L'importance des aires de jeux pour le jeu actif des enfants en plein air
L'importance des aires de jeux pour le jeu actif des enfants en plein air
Objectif : Ce symposium a pour but de présenter une vue d'ensemble de l'importance des aires de jeux pour le jeu actif des enfants en plein air.
Description : Les jeux actifs en plein air sont importants pour la santé et le développement des enfants, et les aires de jeux peuvent constituer de bons endroits pour jouer. Mais comment créer de bonnes aires de jeux dans les espaces publics, les structures d'accueil et d'éducation de la petite enfance (EAJE) et les écoles, que les enfants aiment utiliser pour jouer activement en plein air ? Qu'est-ce qui fonctionne, pour quel type d'enfants, dans quel contexte ?
Dans ce symposium, quatre présentations des États-Unis, de l'Australie et du Danemark mettront en lumière l'importance des aires de jeux dans différents contextes pour le jeu actif en plein air des enfants. En outre, les présentations incluront de nombreuses méthodes nouvelles pour mesurer le jeu actif en plein air, et souligneront l'importance d'impliquer les enfants et les autres parties prenantes dans le développement de nouvelles aires de jeux.
Ensemble, les présentations fourniront des informations précieuses qui peuvent aider les décideurs politiques et les urbanistes à donner la priorité à l'investissement dans les bonnes aires de jeux, dans le bon contexte.
Président : Jasper Schipperijn, Institut mondial de recherche sur les aires de jeux, Université du Danemark du Sud
Présentateur 1 : Hayley Christian, Telethon Kids Institute, Perth, Australie
Présentateur 2 : Deborah Salvo, Université du Texas à Austin, Austin, USA
Présentateur 3 : Charlotte Pawlowski, Institut mondial de recherche sur les aires de jeux, Université du Danemark du Sud
Présentateur 4 : Aaron Hipp, Université d'État de Caroline du Nord, Raleigh, États-Unis
Discutant/modérateur : Jasper Schipperijn, Institut mondial de recherche sur les aires de jeux, Université du Danemark du Sud
Présentation 1 :
Conception d'espaces de jeu pour promouvoir l'activité physique des enfants d'âge préscolaire dans les établissements d'enseignement et d'accueil des jeunes enfants (EAJE)
Auteurs : Hayley Christian1,2, Jasper Schipperijn3, Pulan Bai1,2, Stewart Trost4
1Telethon Kids Institute, Université d'Australie occidentale, Perth, Australie
2School of Population and Global Health, Université d'Australie occidentale, Perth, Australie
3World Playground Research Institute, Université du Danemark du Sud, Odense Danemark
4School of Human Movement and Nutrition Sciences, University of Queensland, Brisbane, Australie
Contexte : Les services de garde d'enfants sont un cadre important pour promouvoir l'activité physique des enfants d'âge préscolaire. L'environnement physique extérieur peut influencer de manière significative l'activité physique des enfants d'âge préscolaire lorsqu'ils fréquentent un centre d'accueil. Peu d'interventions ou d'études utilisant des dispositifs de mesure de l'activité physique des enfants et de l'environnement physique des structures d'accueil ont été réalisées.
Objectif : Résumer les résultats de plusieurs sous-études de la cohorte PLAYCE portant sur l'impact de l'environnement physique extérieur des services de garde d'enfants sur l'activité physique des jeunes enfants.
Méthodes : Les résultats de la première vague de l'étude de cohorte "Play Spaces and Environments for Children's Physical Activity" (PLAYCE) seront présentés et résumés. Lors de la première vague, 1 596 enfants d'âge préscolaire âgés de 2 à 5 ans et leurs parents ont été recrutés dans 104 services de garde d'enfants à Perth, en Australie occidentale. L'activité physique a été mesurée par accélérométrie sur 7 jours et par GPS. L'instrument d'évaluation et d'observation de l'environnement et des politiques (EPAO) et l'imagerie aérienne Nearmap ont permis de saisir l'environnement physique des services d'accueil de la petite enfance.
Résultats : Les bacs à sable, les équipements de jeu portables (ballons, toboggans, équipements de jeu au sol) et les pelouses naturelles ont été positivement associés à l'activité physique des enfants d'âge préscolaire. L'ajout de nouveaux équipements portables (ballons, toboggans, jeux de rotation et jeux au sol) a permis aux enfants participant à l'intervention d'être plus actifs au moment du suivi. Les données spatiales ont confirmé que les points chauds de l'activité physique étaient plus fréquents dans les zones extérieures ouvertes et les zones dotées d'équipements de jeu fixes et de caractéristiques naturelles.
Conclusions : Les équipements de jeu fixes et portables, les caractéristiques naturelles, la quantité d'espace de course dans les aires extérieures des services d'accueil de la petite enfance et leur emplacement par rapport à d'autres aires de jeu sont importants pour favoriser l'activité physique chez les enfants d'âge préscolaire.
Implications pratiques : Étant donné que peu d'enfants d'âge préscolaire respectent les recommandations en matière de jeu énergétique quotidien lorsqu'ils fréquentent un centre d'éducation et de soins de la petite enfance,
les résultats peuvent aider les prestataires de services d'EAJE à optimiser les environnements physiques extérieurs et à encourager les enfants d'âge préscolaire à jouer de manière plus active.
Financement : L'étude PLAYCE a été financée par la Western Australian Health Promotion Foundation (Healthway #32018). HC bénéficie d'une bourse de la Australian National Heart Foundation Future Leader Fellowship (#102549).
Présentation 2 :
Identifier les priorités pour améliorer l'équité d'accès aux aires de jeux à Austin, Texas, États-Unis : une étude à méthodes mixtes et à engagement communautaire
Auteurs : Deborah Salvo1, Case Garza1, Eugen Resendiz1
1 People, Health and Place Lab, Department of Kinesiology and Health Education, The University of Texas at Austin. Austin, Texas, États-Unis
Contexte : Les parcs et les aires de jeux sont des ressources essentielles de l'environnement bâti pour la santé et le développement des enfants. Pour de nombreux enfants, les aires de jeux sont le seul endroit où ils peuvent pratiquer une activité physique après l'école, le week-end et/ou pendant les mois non scolaires.
Objectif : caractériser l'(in)équité de l'accès aux aires de jeux à Austin, Texas, États-Unis, et impliquer les principaux acteurs et membres de la communauté dans l'identification des priorités pour l'amélioration des aires de jeux.
Méthodes : Cette étude utilise une approche mixte. À l'aide d'un SIG, nous cartographions toutes les aires de jeux d'Austin, au Texas, et identifions les quartiers où la disponibilité des aires de jeux est élevée par rapport à ceux où elle est faible. Nous étudierons les différences d'accès aux aires de jeux en fonction des caractéristiques sociodémographiques sous-jacentes des quartiers (revenus, composition raciale/ethnique des résidents) afin de diagnostiquer les inégalités. Nous collectons également des données d'audit et d'imagerie (photographie) dans 8 quartiers à faibles revenus avec une forte proportion de résidents minoritaires, afin d'évaluer l'entretien et la qualité actuels des aires de jeux dans ces zones. En outre, un exercice systématique de cartographie organisationnelle est en cours afin d'identifier les personnes, groupes, organisations et agences clés ayant un intérêt ou une influence sur l'amélioration, la rénovation, l'entretien et la programmation des aires de jeux. Enfin, nous menons deux à cinq entretiens semi-structurés avec des représentants de secteurs clés (parcs et loisirs, sécurité publique, protection de l'environnement, groupes communautaires de création d'espaces), afin d'identifier les priorités en matière d'amélioration des aires de jeux.
Résultats : La collecte des données est en cours et se terminera au début du mois de mai 2023. Les résultats finaux seront présentés à l'ISPAH 2024.
Conclusions : Garantir un accès équitable aux aires de jeux est essentiel pour promouvoir un développement sain chez les enfants et pour atteindre l'activité physique et l'équité en matière de santé.
Implications pratiques : L'utilisation d'une approche fondée sur les données pour identifier les zones à forts besoins et l'engagement des principales parties prenantes, y compris les secteurs publics clés, sont des approches essentielles pour informer la conception et la mise en œuvre de programmes adaptés au contexte afin d'améliorer l'accès et l'utilisation des aires de jeux dans les zones à forts besoins.
Financement : Cette étude a été partiellement financée par le World Playground Research Institute, Université du Danemark du Sud.
Présentation 3 :
Comment concevoir des cours de récréation actives pour les 9-12 ans ?
Auteurs : Charlotte Skau Pawlowski¹, Thea Toft Amholt2, Jasper Schipperijn¹
1World Playground Research Institute, Université du Danemark du Sud, Odense Danemark
2Centre de recherche clinique et de prévention, Hôpital de Frederiksberg, Frederiksberg, Danemark
Contexte : Les cours de récréation sont un lieu unique pour promouvoir l'activité physique des enfants. Cependant, l'activité physique sur les cours de récréation diminue lorsque les enfants grandissent. Plusieurs de nos études ont montré qu'il existe une relation entre l'aménagement des cours de récréation et l'activité physique chez les écoliers plus âgés.
Objectif : L'objectif était de compiler nos données et de formuler des recommandations pour la conception de cours de récréation actives pour les enfants de 9 à 12 ans.
Méthodes : Nous avons compilé les résultats de deux études sur les cours de récréation menées au Danemark entre 2016 et 2022. Dans chacune des études à méthodes mixtes, nous avons examiné la relation entre l'activité physique chez les 9-12 ans et l'aménagement des cours de récréation. À l'aide de données combinées d'accéléromètre et de GPS, nous avons identifié le type de caractéristiques des cours d'école utilisées pour l'activité physique. Grâce à des entretiens, nous avons identifié six types d'enfants ayant des préférences différentes en matière d'activité physique. En combinant les données, nous avons identifié quels éléments de la cour d'école étaient utilisés par quel type d'enfant.
Résultats : Pour stimuler l'utilisation active des enfants de 9 à 12 ans, les cours de récréation doivent comporter une variété d'éléments tels que des zones sociales isolées où ils peuvent se retrouver, des zones avec des défis physiques adaptés à l'âge, tels que des cadres d'escalade élevés qui créent un sentiment de prise de risque, des éléments sportifs tels que des zones de jeu de balle, ainsi que des éléments pour des activités non compétitives. Enfin, il est important qu'il y ait un bon équilibre entre les surfaces pavées et les surfaces naturelles et végétalisées dans la cour d'école.
Conclusions et implications pratiques : Si les cours de récréation sont conçues et construites avec les caractéristiques adéquates, telles que des zones d'isolement, des zones avec des défis physiques adaptés à l'âge, ainsi que des zones sportives et des zones pour des activités non compétitives, les enfants de 9 à 12 ans les utiliseront activement, ce qui influencera positivement leurs niveaux d'activité physique quotidiens totaux.
Financement : Cette étude a été financée par KOMPAN, une grande entreprise internationale de terrains de jeux. KOMPAN n'a eu aucune influence sur les méthodes, les résultats ou les conclusions.
Présentation 4 :
Un jeu d'enfant : que pouvons-nous apprendre des algorithmes de regroupement basés sur l'IA ?
Auteurs : J. Aaron Hipp¹, Jae In Oh1, Morgan Hughey2
1Université d'État de Caroline du Nord, Raleigh, NC, États-Unis
2College of Charleston, Charleston, SC, USA
Contexte : L'étude des aires de jeux s'est traditionnellement appuyée sur des observations, bien que l'utilisation de GPS et d'accéléromètres soit de plus en plus fréquente. L'utilisation de dispositifs de surveillance permet une compréhension plus nuancée de l'utilisation de l'espace, de l'intensité des activités et des endroits où les aires de jeux actuelles peuvent être sous-activées.
Objectif : Nous avons recruté un échantillon diversifié de jeunes sur des terrains de jeux situés dans des quartiers économiquement défavorisés afin de comprendre l'intensité de l'activité sur les terrains de jeux, les préférences en matière d'attributs et les groupes de jeux à l'intérieur et entre les équipements des terrains de jeux.
Méthodes : Des enfants de 5 à 10 ans ont porté un accéléromètre et un GPS lors d'une visite de l'aire de jeux. Chaque équipement de l'aire de jeux a été cartographié à l'aide d'un GPS portable Trimble. Les données du GPS et de l'accéléromètre, avec des périodes de 15 secondes, ont été combinées à l'aide du logiciel HABITUS. Des groupes de jeux, ou épisodes de jeux, ont été créés à l'aide de l'algorithme de regroupement basé sur la densité d'ArcGIS, OPTICS. Les groupes ont été définis avec un minimum de cinq points consécutifs (1 minute) et une distance maximale de 6 m entre les points. Les résultats d'OPTICS fournissent des grappes de jeu à travers le temps de port d'un individu, ce qui permet de visualiser et de décrire le jeu à travers le temps et l'espace.
Résultats : L'ensemble des données comprenait 40 000 épisodes de 15 secondes d'utilisation de l'aire de jeux par 321 jeunes. OPTICS a identifié 1 727 épisodes de jeu. La visite moyenne d'un terrain de jeu comprenait cinq épisodes de jeu de trois minutes. 37% des épisodes de jeu se sont produits sur des jeux, suivis par 8% d'épisodes sur des balançoires. 43% des épisodes de jeu se sont déroulés entre différentes aires de jeu à l'intérieur des aires de jeu (par exemple, jouer sur le toboggan puis courir directement vers les balançoires).
Conclusions : Les épisodes de jeu des jeunes sont variés et se déroulent souvent entre les équipements de jeu fournis ou au-delà de ceux-ci. Il est nécessaire de poursuivre les recherches sur la disposition et la conception des équipements qui favorisent le plus le jeu actif et créatif et incitent les jeunes à revenir.
Implications pratiques : La compréhension des épisodes de jeu sur les terrains de jeu peut contribuer à la conception d'équipements spécifiques, à la disposition de divers équipements sur un terrain de jeu et à l'activation d'espaces sous-utilisés.
Financement : Fondation Robert Wood Johnson
Auteur de la soumission
Groupe de population
Type d'étude
Paramètres
Evaluation de l'activité physique dans la vie réelle - Perspectives du projet européen WEALTH
Auteur de la soumission
Groupe de population
Type d'étude
Paramètres
Viser l'équité mondiale en matière d'activité physique : réflexions de l'Alliance mondiale Active Healthy Kids
Auteur de la soumission
Groupe de population
Type d'étude
Paramètres
Les gens, la santé et le lieu en Amérique latine et chez les Latinos : Leçons pour la promotion de l'activité physique au niveau mondial
Auteur de la soumission
Groupe de population
Type d'étude
Paramètres
Le consortium ProPASS : Croissance, succès, défis et orientations futures d'un consortium international sur les wearables
Objectif : explorer le développement d'un consortium international de premier plan dans le domaine des études d'observation des comportements physiques, y compris ses défis, son potentiel scientifique, ses orientations futures et ses objectifs à long terme.
Description : Le développement de consortiums internationaux d'études observationnelles sur les comportements physiques offre une opportunité sans précédent de comprendre les liens entre la santé du mouvement et la maladie, et de répondre aux priorités mondiales de santé publique. Depuis sa création en 2017, le consortium ProPASS (Prospective Studies of Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep) s'est développé à un rythme soutenu pour inclure plus de 30 grandes études d'observation provenant de 5 continents, et est idéalement placé pour informer la prochaine génération de lignes directrices et de promotion de l'activité physique.
Lors de ce symposium, nous partagerons le parcours historique et le développement de ProPASS, son succès à ce jour, les nouveaux chantiers passionnants et une vision pour l'avenir. Le symposium comprendra trois sessions de présentation, au cours desquelles les délégués entendront six membres du groupe de direction de ProPASS, suivies d'un débat interactif auquel participeront certains de nos estimés collaborateurs internationaux.
Dans le premier de ces exposés, les professeurs Emmanuel Stamatakis (Université de Sydney) et Mark Hamer (University College London) présenteront la mission de ProPASS et son impact potentiel futur, et partageront des idées précieuses concernant les opportunités et les défis créés par le succès et la croissance continue de ProPASS. La deuxième présentation se concentrera sur les principales réussites des 12 derniers mois. Les docteurs Jo Blodgett (University College London) et Matthew Ahmadi (University of Sydney) décriront les premiers articles issus de l'analyse des données regroupées de ProPASS, qui se concentrent sur la santé cardiométabolique et les associations avec l'intensité, la durée et le type de comportements de mouvement. Dans notre troisième présentation, dirigée par le professeur associé Annemarie Koster (Université de Maastricht) avec le Dr Jo Blodgett et le Dr Matthew Ahmadi, les délégués auront l'occasion d'entendre parler de nouvelles orientations et de nouveaux chantiers passionnants impliquant des approches compositionnelles, l'exploration du volume et de la variabilité du sommeil mesurés par des appareils, et des micropatterns d'activité physique.
Le symposium se terminera par un débat interactif au cours duquel les délégués et notre groupe d'experts pourront examiner des questions clés et partager des idées sur le sujet : Le présent et l'avenir de la recherche sur l'observation du comportement physique : le rôle des appareils portables".
Président : Dr Richard Pulsford. Faculté des sciences de la vie et de la santé. Université d'Exeter, Royaume-Uni
Présentateurs
Session 1 :
- Professeur Emmanuel Stamatakis. Centre Charles Perkins, École des sciences de la santé, Faculté de médecine et de santé, Université de Sydney, Sydney, Australie,
- Professeur Mark Hamer, Institut du sport, de l'exercice et de la santé, UCL, Londres, Royaume-Uni
Session 2 :
- Dr Joanna M Blodgett. Institute of Sport Exercise & Health, UCL, et University College London Hospitals NIHR Biomedical Research Centre, Londres, Royaume-Uni.
- Dr Matthew Ahmadi. Centre Charles Perkins, École des sciences de la santé, Faculté de médecine et de santé, Université de Sydney, Sydney, Australie.
Session 3 :
- Dr Joanna M Blodgett. Institute of Sport Exercise & Health, UCL, et University College London Hospitals NIHR Biomedical Research Centre, Londres, Royaume-Uni.
- Dr Matthew Ahmadi. Centre Charles Perkins, École des sciences de la santé, Faculté de médecine et de santé, Université de Sydney, Sydney, Australie.
- Professeur associé Annemarie Koster. Département de médecine sociale, Institut de recherche sur les soins et la santé publique CAPHRI, Université de Maastricht, Maastricht, Pays-Bas.
Résumé 1 : Vision et impact potentiel du consortium ProPASS : assurer la longévité des grandes collaborations internationales en matière d'activité physique
Intervenants : Emmanuel Stamatakis, Mark Hamer
Contexte : Le consortium Prospective Physical Activity, Sitting, and Sleep (ProPASS) a été lancé en 2017 pour mener la transition vers des preuves basées sur les wearables pour l'activité physique, le comportement sédentaire et l'élaboration de lignes directrices sur le sommeil. ProPASS implique actuellement c>100 collaborateurs et près de 30 études de cohorte. En tant que consortium international, ProPASS est unique en ce sens qu'il n'a pas été mis en place simplement comme une ressource de données, ses activités comprennent le développement de la méthodologie, l'expansion prospective à de nouvelles cohortes, y compris un partenariat ISPAH formel axé sur les PRFM, et le soutien aux chercheurs en début de carrière.
Objectif : décrire la portée, la vision et l'impact potentiel futur de ProPASS, et partager avec la communauté ISPAH les leçons apprises au cours de son développement.
Méthodes : Nous discuterons d'abord de l'émergence de ProPASS, de sa vision et de la stratégie pour la réaliser, des défis rencontrés et de son impact actuel et futur probable. La deuxième partie de cette session se concentrera sur la stratégie de financement et les défis et mettra en évidence le chemin à parcourir dans les 4 à 5 prochaines années lorsque le travail pour le développement des prochaines lignes directrices de l'OMS commencera probablement.
Résultats : En dépit des conditions de financement défavorables généralement rencontrées dans la recherche épidémiologique, ProPASS s'est développé très rapidement et a déjà un impact dans les domaines plus larges du comportement physique et de l'activité physique. Cependant, sa trajectoire à ce jour n'est pas une garantie de succès pour l'avenir. Au fur et à mesure que ProPASS se développe, l'étendue de ses activités et ses besoins en ressources augmentent. Cela crée des opportunités pour un plus grand impact, mais pose également des menaces sur sa longévité.
Conclusions : Bien que ProPASS repose sur des bases solides, les cinq prochaines années seront décisives pour déterminer dans quelle mesure ProPASS réalisera sa vision. Le soutien d'organisations telles qu'ISPAH et de sa communauté sera probablement déterminant pour son succès.
Implications pratiques : Nous partagerons avec le congrès de l'ISPAH les idées et les leçons tirées du consortium ProPASS et mettrons en évidence les orientations futures.
Résumé 2. Principaux succès du consortium ProPASS : premiers articles publiés par six cohortes issues de notre ressource pilote
Intervenants : Joanna M Blodgett, Matthew Ahmadi
Contexte : Nous résumons ici les résultats des premiers articles empiriques de ProPASS, publiés l'année dernière dans le European Heart Journal et Diabetologia.
Objectif : Nous avons étudié : i) les associations interdépendantes entre l'activité physique modérée-vigoureuse (APMV), l'AP d'intensité légère (APIL), la station debout, le comportement sédentaire (CS) et le sommeil avec les résultats cardiométaboliques ; et ii) les associations dose-réponse entre le type d'activité (station debout, marche, montée d'escaliers, marche rapide/course à pied) et les résultats cardiométaboliques.
Méthodes : Nous avons regroupé les données de six études de cohorte (n>15 000). Les données brutes des accéléromètres ont été retraitées à l'aide du logiciel ActiPASS. Pour l'objectif i, nous avons effectué une régression logistique compositionnelle afin d'explorer les associations entre diverses compositions du temps consacré aux comportements de mouvement et six résultats cardiométaboliques, et d'étudier diverses estimations de modélisation de la réaffectation comportementale. Pour l'objectif ii, nous avons utilisé des modèles linéaires généralisés avec des splines pour étudier les relations dose-réponse entre les types d'activité et chaque résultat.
Résultats : Objectif i) Plus d'APVM et moins de temps passé dans la sédentarité - par rapport au sommeil, à la station debout et à l'activité légère - sont associés à de meilleurs résultats cardiométaboliques. Une réaffectation de moins de 10 minutes par jour d'autres comportements au profit de l'APV était associée à des améliorations significatives des résultats. Objectif ii) Accumuler >5 min/jour (z-score= -0.14 [-0.24, -0.03] de montée d'escaliers ou >64 min/jour (-0.14 [-0.25, -0.02] de marche) était associé à une santé cardiométabolique composite plus favorable. Chaque minute supplémentaire de montée d'escalier jusqu'à 12 min/jour était associée à un taux de changement similaire à celui de la course à pied pour le même intervalle de temps
Conclusions : Les résultats sur les comportements de mouvement sur 24 heures peuvent guider des conseils plus personnalisés sur la manière dont un individu peut modifier ses mouvements sur 24 heures pour en tirer des bénéfices cardiométaboliques. Les résultats sur la santé cardiométabolique et les durées des différentes activités de la vie quotidienne et de la posture peuvent guider les interventions futures impliquant une modification du mode de vie.
Implications pratiques : Cette session permettra de partager avec le public du congrès ISPAH les premiers résultats de l'expérience du consortium ProPASS à ce jour et de présenter les futurs domaines de recherche.
Implications pratiques : Cette session permettra de partager avec le public du congrès ISPAH les premiers résultats de l'expérience du consortium ProPASS à ce jour et de présenter les futurs domaines de recherche.
Résumé 3. Nouvelles orientations et résultats émergents de la première ressource ProPASS
Annemarie Koster, Joanna M Blodgett, Matthew Ahmadi
Contexte : Les avantages pour la santé d'une activité physique modérée à vigoureuse et du sommeil sont bien décrits. On en sait beaucoup moins sur les schémas d'activité physique et de santé et, en particulier, sur les avantages potentiels pour la santé de très courtes périodes d'activité dans la vie quotidienne. En outre, peu d'études ont examiné l'ensemble des comportements quotidiens en matière de mouvement (y compris le sommeil) et évalué leurs interdépendances avec les résultats en matière de santé.
Objectif : Dans cette session, nous présentons les résultats des analyses en cours du consortium ProPASS sur i) l'association entre les micropatterns d'activité et ii) la durée et la régularité du sommeil avec les résultats cardiométaboliques ; iii) les analyses compositionnelles des données individuelles des participants sur le comportement sédentaire, le sommeil, la station debout, la marche (légère et rapide) et les comportements similaires à l'exercice avec la pression artérielle.
Méthodes : Dans le cadre du premier recours à ProPASS, nous avons harmonisé les données de plus de 15 000 participants provenant de six études de cohortes internationales. Les résultats comprenaient l'indice de masse corporelle, le tour de taille, le cholestérol à lipoprotéines de haute densité, le cholestérol total, les triglycérides, l'HbA1c, la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique.
Résultats : Nous utiliserons des modèles linéaires généralisés avec des splines pour examiner les associations dose-réponse entre les micro-modèles d'activité physique (objectif i) et de sommeil (objectif ii) et les résultats cardiométaboliques. Nous effectuerons une analyse des données de composition pour examiner les associations entre les différentes compositions du temps consacré aux comportements de mouvement et chaque résultat de pression artérielle, y compris l'examen de la réaffectation minimale et optimale du temps entre les comportements (objectif iii).
Conclusions : Ces études permettront de mieux comprendre les associations entre de nouveaux aspects du comportement physique et la santé, ainsi que la manière dont la réaffectation du temps consacré à un comportement par un autre comportement influe sur la santé.
Implications pratiques : Cette session montre la valeur scientifique de la première ressource ProPASS pour une nouvelle recherche sur le comportement physique et la santé.
Financement (tous les résumés) : British Heart Foundation Special Grant (SP/F/20/150002) ; NHMRC (Australie) Investigator Grant (APP1194510) ; NHMRC Ideas Grant (APP1180812) ; Cancer Research UK Prevention and Population Grant (PRCPJT-Nov23/100005) ; PAL Technologies ; University of Sydney Research Accelerator (SOAR) ; WUN, The Worldwide Universities Network ; Charles Perkins Centre, University of Sydney.
Auteur de la soumission
Groupe de population
Type d'étude
Paramètres
Lignes directrices générales pour les symposiums
Pour le 10e congrès de l'ISPAH, nous recherchons une large représentation de symposiums et d'ateliers de la communauté internationale, y compris des régions sous-représentées. Le temps disponible pour chaque symposium sera de 75 min, et toutes les présentations doivent être en personne, sans options hybrides. Tous les intervenants du symposium doivent être inscrits avant le 15 septembre 2024 pour que le symposium reste au programme.
- Le congrès de l'ISPAH est le plus grand forum mondial sur l'activité physique et la santé publique. Par conséquent, les intervenants d'un symposium doivent être aussi diversifiés que possible et provenir d'au moins deux pays différents.
- Deux types de symposiums sont proposés : un symposium régulier et un symposium de débat.
- Pour les deux types de symposiums, le coordinateur (président) doit soumettre un résumé décrivant l'objectif général du symposium, la liste des intervenants et les modalités d'interaction avec le public.
- Chaque présentateur du symposium doit préparer un résumé individuel en suivant le même format que les résumés des présentations orales et des affiches. Le président inclura également les résumés des présentateurs individuels dans leur soumission au symposium en tant que soumission collective.
- Les résumés doivent être formatés conformément aux directives et soumis sur le portail de soumission du site web du congrès de l'ISPAH.
- Chaque président peut soumettre un résumé de symposium. Pour tous les symposiums, les résumés doivent suivre le plus fidèlement possible les lignes directrices ci-dessous. Le titre doit être bref, pas plus de 15 mots. L'objectif collectif et les détails de la description ne doivent pas dépasser 300 mots.
- Les présentations soumises dans le cadre d'un symposium qui n'a pas été sélectionné sont invitées à se représenter pour des présentations orales et des affiches électroniques, sauf demande contraire.
A noter : Tous les résumés doivent être soumis en Anglais. Un auteur principal peut soumettre un maximum de 2 résumés. Ils peuvent également figurer sur d'autres résumés en tant qu'auteurs ou présentateurs supplémentaires.
Communications : Toute communication concernant la réception et la notification de votre résumé se fera par courrier électronique. Veuillez vous référer à notre dates clés pour connaître les échéances importantes. Les notifications seront envoyées au plus tard aux dates spécifiées. Un courriel automatisé sera envoyé avec un numéro d'identification unique pour le résumé. Veuillez utiliser ce numéro dans toute communication. Si vous devez retirer la soumission d'un résumé, veuillez le faire en utilisant l'option "Retirer" sur votre tableau de bord des résumés.
Format du résumé final : Afin d'accueillir le plus grand nombre possible de présentateurs, l'ISPAH a mis en place une politique selon laquelle un seul résumé par auteur peut être sélectionné pour une présentation orale. Les auteurs dont les soumissions ne sont pas incluses dans les sessions orales auront la possibilité de participer en tant que présentateurs d'affiches électroniques. Ce format comprend une brève présentation en personne de 3 minutes de leurs e-posters pendant les sessions e-poster désignées. Le format final de votre résumé sera détaillé dans votre abstract outcome email si votre résumé a été accepté. Les détails peuvent également être consultés sur votre tableau de bord des résumés.
Remarque importante : L'auteur de la présentation MUST être inscrit au congrès et être responsable des frais d'inscription (ainsi que des frais d'hébergement et de déplacement, le cas échéant). En cas de changement d'auteur, veuillez en informer le comité d'organisation en envoyant un courriel via notre formulaire d'assistance dans votre tableau de bord des résumés, au plus tard le 15 septembre 2024. Si l'auteur présentateur n'est pas inscrit avant le 15 septembre, la soumission sera retirée du programme.
Lignes directrices pour les symposiums réguliers
Les symposiums réguliers sont présidés par une personne qui présente brièvement un sujet spécifique, suivi de 3 à 5 intervenants, puis d'une discussion impliquant activement le public, souvent dirigée par un discutant ou un modérateur. Le président peut jouer le rôle de discutant ou de modérateur s'il n'est pas l'un des présentateurs.
Critères de soumission
- Provenant d'au moins 3 organisations différentes de 2 pays différents
- Y compris 3 à 5 présentations
- Les résumés doivent inclure une déclaration claire sur la manière dont l'interaction avec le public sera stimulée.
La structure devrait être la suivante :
Titre : Le titre doit représenter le sujet général (max 15 mots)
Objet : Indiquer l'objectif principal de ce symposium.
Description : Inclure une description générale du symposium (l'objectif et la description ne doivent pas dépasser 300 mots).
Président (nom et affiliation):
Présentateur 1 (nom et affiliation) :
Présentateur 2 (nom et affiliation) :
Présentateur 3 (nom et affiliation) :
Discutant/modérateur (nom et affiliation) :
Après le résumé général du symposium, le président devra inclure les résumés individuels de chaque présentateur. Chaque présentateur doit préparer un résumé individuel en suivant le même format que les résumés oraux et les résumés d'affiches électroniques, en veillant à ce que le titre ne soit pas supérieur à 15 mots et la description un maximum de 300 mots pour chaque résumé individuel :
Résumés de recherche
Contexte :
Objet :
Méthodes :
Résultats :
Conclusions :
Implications pratiques :
Financement :
Résumés de pratique/politique
Contexte :
Composantes de l'exécution du programme ou de la politique :
Évaluation :
Conclusions :
Implications pratiques :
Financement :
Lignes directrices pour les symposiums de débat
Ces sessions dureront 75 minutes et donneront lieu à un débat entre deux équipes ayant une vision différente d'un sujet particulier, avant de laisser place aux questions et réponses et à l'interaction avec le public.
Critères de soumission
1) Les orateurs doivent provenir d'au moins deux organisations différentes de deux pays différents.
2) Les résumés doivent inclure une déclaration claire sur la manière dont l'interaction avec le public sera stimulée.
Les symposiums de débat seront dirigés par un président ou un modérateur qui présentera une introduction sur un sujet controversé spécifique (environ 10 minutes). Ensuite, des intervenants favorables et défavorables (1 ou 2 pour chaque camp) présenteront des arguments "pour" et "contre" le thème du débat (15 à 20 minutes chacun). Chaque partie doit présenter sa position initiale, qui sera suivie d'une réfutation de chaque partie. S'il y a deux présentateurs pour chaque camp, l'un d'entre eux doit faire la présentation initiale tandis que l'autre doit présenter la réfutation. Cette présentation sera suivie d'une discussion de 30 minutes.
Titre : Le titre doit représenter le sujet et sa nature controversée.
Objet : Une déclaration sur l'objectif du débat, mettant l'accent sur le caractère innovant du sujet (y compris une brève description du sujet).
Raison d'être : Pourquoi ce sujet mérite-t-il d'être abordé lors de cette conférence et pourquoi est-il discutable ?
Président (nom et affiliation) : Introduction au débat
Présentation(s) affirmative(s) [nom(s) et affiliation(s)] : Titre et brève description
Présentation(s) contradictoire(s) [nom(s) et affiliation(s)] : Titre et brève description
Présentation d'un autre point de vue [facultatif] [Nom(s) et affiliation(s)] : Titre et brève description
Conclusions ou résultats : Identifier les principales conclusions ou résultats attendus de ce débat innovant.